 La trame de La route de Beit Zera d’Hubert Mingarelli est limpide : un homme âgé vit avec sa chienne qui va bientôt mourir dans une maison isolée ; un adolescent rend souvent visite à l’animal. Le vieil homme fabrique des boîtes en carton dans le but de rejoindre son fils qui se trouve en Nouvelle-Zélande.
La trame de La route de Beit Zera d’Hubert Mingarelli est limpide : un homme âgé vit avec sa chienne qui va bientôt mourir dans une maison isolée ; un adolescent rend souvent visite à l’animal. Le vieil homme fabrique des boîtes en carton dans le but de rejoindre son fils qui se trouve en Nouvelle-Zélande.
L’histoire se déroule en Israël, près du lac de Tibériade et de la ville de Beit Zera. Stépan fabrique les boîtes pour Eran, son ami depuis qu’ils ont fait le service militaire ensemble.
Une histoire où il ne se passe pas grand chose, où la violence du conflit israélo-palestinien n’apparaît pas au premier abord, aucune allusion, juste un quotidien routinier :
Une fois par mois, Samuelson passait à la coopérative de Beit Zera et achetait pour Stépan de quoi boire, manger et fumer. Vers le soir, il garait son camion devant la baraque en planches et aidait Stépan à porter ses provisions dans la maison. Ensuite ils chargeaient les boîtes façonnées durant la semaine. Puis ils restaient dehors sous la véranda et prenaient une cuite.

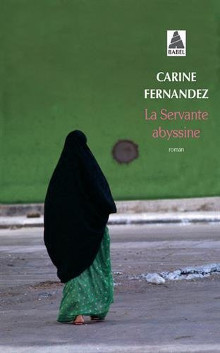 Janvier : rentrée littéraire, mois du blanc et des soldes. Dans le désordre. Les sociologues nous apprennent que nos habitudes de consommation changent : on veut désormais du solide, du durable, on se précipite moins sur le miroir aux alouettes, paraît-il.
Janvier : rentrée littéraire, mois du blanc et des soldes. Dans le désordre. Les sociologues nous apprennent que nos habitudes de consommation changent : on veut désormais du solide, du durable, on se précipite moins sur le miroir aux alouettes, paraît-il. Une femme atteint la gloire dans le milieu très masculin de la cuisine alors que rien dans son origine sociale ne la prédisposait à un tel destin. L’ex-assistant et amoureux transi de la Cheffe raconte la vie de celle-ci telle qu’il a pu la reconstituer. À ce récit primitif s’entrelarde la vie du narrateur en Espagne dans un de ces ghettos pour retraités français de la classe moyenne (description cruelle et très réussie de ces vieux qui se comportent comme des jeunes, histoire d’avoir réussi leur vie).
Une femme atteint la gloire dans le milieu très masculin de la cuisine alors que rien dans son origine sociale ne la prédisposait à un tel destin. L’ex-assistant et amoureux transi de la Cheffe raconte la vie de celle-ci telle qu’il a pu la reconstituer. À ce récit primitif s’entrelarde la vie du narrateur en Espagne dans un de ces ghettos pour retraités français de la classe moyenne (description cruelle et très réussie de ces vieux qui se comportent comme des jeunes, histoire d’avoir réussi leur vie).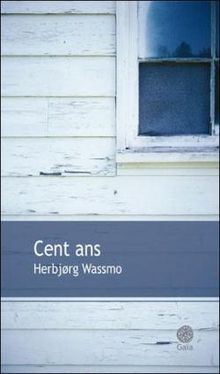 Je vous propose une saga norvégienne familiale, pour sortir de l’hexagone et de ses micro-tourments biographiques : Cent ans de la vie d’une famille vus à travers le regard des femmes qui se succèdent de génération en génération.
Je vous propose une saga norvégienne familiale, pour sortir de l’hexagone et de ses micro-tourments biographiques : Cent ans de la vie d’une famille vus à travers le regard des femmes qui se succèdent de génération en génération.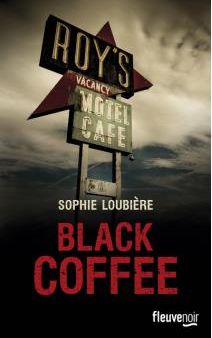 Voilà un roman policier qui cumule le meilleur et le pire de ce que l’on peut écrire.
Voilà un roman policier qui cumule le meilleur et le pire de ce que l’on peut écrire.