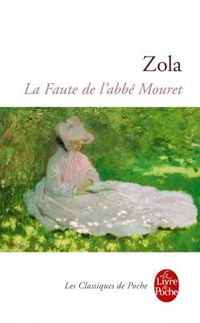Les nouvelles sont mauvaises comme le serine la chanson, et la littérature sert parfois à se réfugier dans un paradis perdu, comme l’île de Lesbos, mais une île d’avant le tourisme, une île rêvée où les bergers et bergères s’aiment d’un amour pur et où le lecteur sourit de leur naïveté avec attendrissement. Redécouvrez Daphnis et Chloé de Longus…
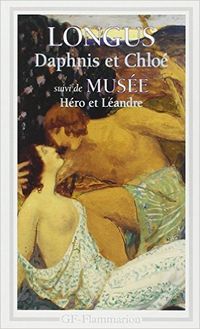 Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…
Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…
Bien sûr, ces deux enfants recueillis par des paysans esclaves ne ressemblent pas à leurs pseudo-géniteurs : tant de beauté ne peut provenir d’une basse extraction !
Bien sûr les amoureux vont se trouver confrontés à des obstacles variés : pirates, enlèvements, initiation sexuelle de Daphnis par une femme du voisinage, tentative de séduction homosexuelle pour le même Daphnis, de viol pour Chloé, bref de quoi pimenter ces amours bucoliques, tout cela sous le regard bienveillant des nymphes et des chèvres et au son de la syrinx de Daphnis. Que de contrariétés ! Que l’on se rassure : à la fin les géniteurs repentants reconnaissent les objets exposés en même temps que leur enfant respectif, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et Daphnis et Chloé vont enfin pouvoir convoler…
Pourquoi relire cette pastorale antique datant du IIe. ou IIIe siècle de l’ère chrétienne ? Pourquoi éprouver tant de plaisir à redécouvrir ce livre oublié en pleine saison littéraire ? Justement à cause de ce moment aussi artificiel que les promotions de Noël ou les soldes de janvier. Et peut-être aussi parce que, près avoir lu Mémoire de fille le dernier livre d’Annie Ernaux avec son initiation sexuelle glaçante, la poésie, l’humour et la douceur, la tendresse et l’érotisme de ce livre exhumé de siècles lointains, ce livre d’un auteur dont on ne sait rien mais qui a si bien conté ces « jeux de bergers » apporte une fraîcheur bienvenue. Parce que ce dépaysement suscite la nostalgie et que, malgré soi, on est troublé et attendri par ces enfants maladroits qui se cherchent, s’excitent, s’énervent de leurs désirs dans leur paradis terrestre :
Et c’était, un peu partout, le bêlement des brebis ; les agneaux gambadaient, s’agenouillaient sous leur mère et tiraient sur leur pis ; les brebis qui n’avaient pas encore porté étaient poursuivies par les béliers qui grimpaient sur elle, les immobilisaient et les saillaient, un peu partout. Les boucs, eux aussi, poursuivaient les chèvres et bondissaient sur elles, pleins de désirs, et ils se les disputaient entre eux. (…) Ce spectacle eût incité à l’amour même des hommes vieillissants ; et eux, qui étaient jeunes, pleins de sève et qui, depuis longtemps, étaient en quête de l’amour, se sentaient brûlés à ce qu’ils entendaient, et fondre à ce qu’ils voyaient, et cherchaient, eux aussi, quelque chose de plus que de se donner des baisers et se prendre dans les bras, surtout Daphnis. Car il avait grandi pendant le temps passé au logis dans l’oisiveté, et ses baisers étaient pleins d’ardeur, il s’adonnait avec passion aux embrassements, et se montrait plus curieux et hardi dans toutes ses entreprises.
Il demandait à Chloé de lui accorder tout ce qu’il voulait, et de se coucher toute nue contre son corps tout nu, plus longuement qu’ils ne faisaient auparavant.
Les descriptions de la nature débordent d’un lyrisme dont on peut se moquer, mais elles vibrent d’un jaillissement de sève rarement atteint sauf peut-être, bien des siècles plus tard, chez Émile Zola lorsqu’il écrit La Faute de l’Abbé Mouret, le cinquième volume des Rougon-Maquart. S’est-il souvenu et inspiré de la pastorale de Longus lorsqu’il a écrit les merveilleuses pages où Serge s’éveille au Paradou ? Celles-ci évoquent le même affolement des sens d’un naïf garçon confronté à ses désirs.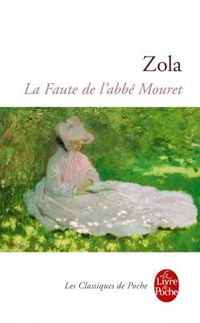
Ce fut comme une vision de forêt vierge, un enfoncement de futaie immense, sous une pluie de soleil. Dans cet éclair, le prêtre saisit nettement, au loin, des détails précis : une grande fleur jaune au centre d’une pelouse, une nappe d’eau qui tombait d’une haute pierre, un arbre colossal empli d’un vol d’oiseaux ; le tout noyé, perdu, flambant, au milieu d’un tel gâchis de verdure, d’une débauche telle de végétation, que l’horizon entier n’était plus qu’un épanouissement.
Une poésie de la jubilation de la nature, un brin excessive peut-être, mais si pleine d’allégresse, si vibrante ! Hélas, nous ne sommes pas dans une pastorale mais dans une démonstration du poids funeste de la religion et l’histoire se terminera très mal pour les deux jeunes gens. N’empêche, je ne peux que vous recommander ces deux livres qui, à presque deux mille ans de distance, suscitent des vibrations intenses grâce à une nature qui se trouve en si grand danger.
Et nous voilà revenus à l’actualité, la COP 22Roman, les changements climatiques, le nouveau président américain : la littérature est un remède à effets limités…
Daphnis et ChloéLongus
Traduit par Aline Tallet-Bonvalot
Flammarion, 168 p., 3,90 €
ISBN : 978-2080708199
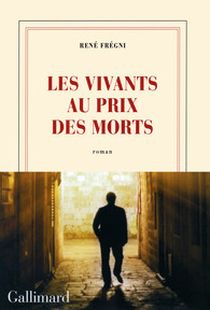 Vous est-il arrivé de lire un livre à cause de son titre ? Personnellement cela m’arrive très souvent, l’appel du titre c’est comme l’air du large quand il est plein de sel, de mystère et de nostalgie. Les vivants au prix des morts, quel titre magnifique !
Vous est-il arrivé de lire un livre à cause de son titre ? Personnellement cela m’arrive très souvent, l’appel du titre c’est comme l’air du large quand il est plein de sel, de mystère et de nostalgie. Les vivants au prix des morts, quel titre magnifique !
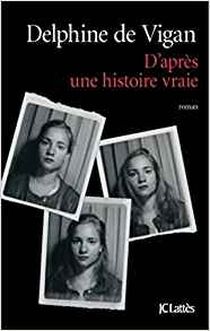
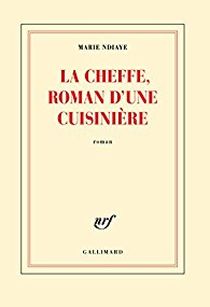 Une femme atteint la gloire dans le milieu très masculin de la cuisine alors que rien dans son origine sociale ne la prédisposait à un tel destin. L’ex-assistant et amoureux transi de la Cheffe raconte la vie de celle-ci telle qu’il a pu la reconstituer. À ce récit primitif s’entrelarde la vie du narrateur en Espagne dans un de ces ghettos pour retraités français de la classe moyenne (description cruelle et très réussie de ces vieux qui se comportent comme des jeunes, histoire d’avoir réussi leur vie).
Une femme atteint la gloire dans le milieu très masculin de la cuisine alors que rien dans son origine sociale ne la prédisposait à un tel destin. L’ex-assistant et amoureux transi de la Cheffe raconte la vie de celle-ci telle qu’il a pu la reconstituer. À ce récit primitif s’entrelarde la vie du narrateur en Espagne dans un de ces ghettos pour retraités français de la classe moyenne (description cruelle et très réussie de ces vieux qui se comportent comme des jeunes, histoire d’avoir réussi leur vie).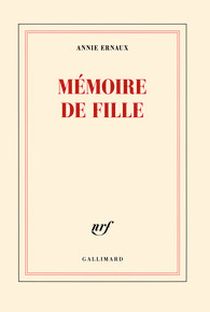 On sait que l’auteur poursuit depuis maintenant plus de quarante ans le même sillon autobiographique, loin des complaisances de certain(e)s, loin de tout sentimentalisme, loin de tout pittoresque. Une série de faits, de constats, d’immersion au plus près de la vérité de l’être. Une femme qui restitue avec une force d’évocation sidérante les étapes importantes de sa vie. Une femme qui marche, si proche de l’homme de Giacometti, si universelle. Bouleversante. Choquante. Quoi, si peu d’affection pour cette jeune fille naïve et perdue ? Quoi, une loupe d’entomologiste pour restituer ses humiliations, son entêtement, sa bêtise même ? Quoi, si peu de dignité pour révéler l’étendue du mépris dont elle a été victime ?
On sait que l’auteur poursuit depuis maintenant plus de quarante ans le même sillon autobiographique, loin des complaisances de certain(e)s, loin de tout sentimentalisme, loin de tout pittoresque. Une série de faits, de constats, d’immersion au plus près de la vérité de l’être. Une femme qui restitue avec une force d’évocation sidérante les étapes importantes de sa vie. Une femme qui marche, si proche de l’homme de Giacometti, si universelle. Bouleversante. Choquante. Quoi, si peu d’affection pour cette jeune fille naïve et perdue ? Quoi, une loupe d’entomologiste pour restituer ses humiliations, son entêtement, sa bêtise même ? Quoi, si peu de dignité pour révéler l’étendue du mépris dont elle a été victime ?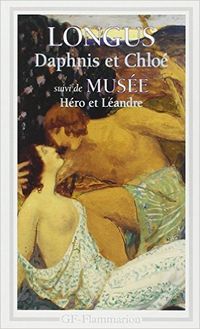 Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…
Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…