Le Rwanda était un petit pays d’Afrique inconnu de la plupart des Européens il y a une vingtaine d’années. Tout changea en avril 1994 lorsque les premiers témoignages racontèrent les atrocités qui s’y passaient. Durant cent jours, entre huit cent mille et un million de Tutsi ont été massacrés par les Hutu, soit les trois quart de la population tutsi.
Les tutsi, les cafards, comme les surnomment les Hutu, les cafards à exterminer.
L’écrivaine rwandaise Scholastique Mukasonga, française par son mariage avec un coopérant rencontré au Burundi, se trouvait au moment des événements en Normandie où elle vivait avec son mari français et ses deux enfants. Cela lui a sauvé la vie.
Comment continuer après le massacre de presque toute sa famille ? Comment écrire lorsque l’on n’a dû son salut qu’au fait de se trouver à l’extérieur du pays au moment du génocide ? Toute l’écriture de Scholastique Mukasonga tourne autour de de cette problématique.
J’ai parlé des difficultés de l’autobiographe à capter le réel ; c’est bien plus compliqué lorsque les circonstances de la vie sont mêlées à un événement aussi épouvantable. L’auteure doit avoir à l’esprit à chaque instant, au moment où elle écrit et tente de faire revivre son passé pour ses lecteurs, le massacre qui a laminé les siens.
Le récit de Scholastique Mukasonga est un excellent exemple de la façon dont un écrivain peut transcender la matière de sa vie, la dépasser pour en faire un objet à la fois ethnologique, historique et sociologique. Dans ce retour sur l’enfant et la jeune fille d’autrefois, c’est tout un monde disparu que l’auteure ressuscite.
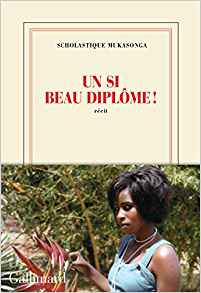 Un si beau diplôme ! raconte l’obstination de l’auteure a obtenir le diplôme d’assistante sociale, c’est le fil conducteur de ce récit autobiographique. Cette quête du diplôme commence dès l’enfance, et ce n’est pas pour rien que l’auteure dédie son livre à son père, Cosmas, « pour qui seule l’école pouvait sauver la mémoire », ce père qui ne voyait de salut pour ses enfants que dans un diplôme. Cosmas savait mieux que personne que les Tutsis étaient en sursis, lui qui avait été forcé d’accepter le regroupement des Hutu et pressentait le pire.
Un si beau diplôme ! raconte l’obstination de l’auteure a obtenir le diplôme d’assistante sociale, c’est le fil conducteur de ce récit autobiographique. Cette quête du diplôme commence dès l’enfance, et ce n’est pas pour rien que l’auteure dédie son livre à son père, Cosmas, « pour qui seule l’école pouvait sauver la mémoire », ce père qui ne voyait de salut pour ses enfants que dans un diplôme. Cosmas savait mieux que personne que les Tutsis étaient en sursis, lui qui avait été forcé d’accepter le regroupement des Hutu et pressentait le pire.
En tout cas, […] c’est ce papier, si tu l’as un jour et il te le faudra, idipolomi nziza, un beau diplôme, c’est ce qui te sauvera de la mort qui nous est promise, garde-le toujours sur toi comme le talisman, ton passeport pour la vie. (p. 12)
La petite fille veut devenir assistance sociale, mais elle sait que cela risque d’être difficile « puisque ma carte d’identité portait, comme une marque infamante, la mention TUTSI. » Continuer la lecture

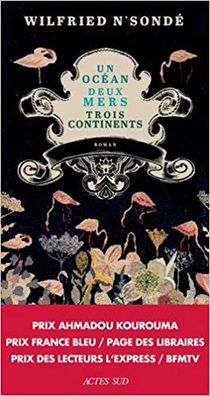
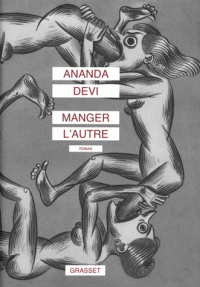 L’héroïne de Manger l’autre est une adolescente d’une obésité hors norme : elle pèse plus de dix kilos à sa naissance et déchire sa mère dans tous les sens du terme. Cette dernière fuira très vite, ainsi que toutes les nourrices qui se succéderont pour nourrir ce bébé à l’appétit insatiable. Bien sûr on ne peut que penser à Gargantua, le monstrueux bébé de Rabelais. Les illustrations de Gustave Doré ont peut-être inspiré l’auteur, qui sait ? Le livre est tellement visuel ! Cet aspect rabelaisien, ce côté « hénaurme » est essentiel ; la lecture du roman serait insoutenable sans la truculence et l’excès de nourriture, les descriptions gourmandes des repas concoctés par le père aimant, à la fois remèdes et poisons.
L’héroïne de Manger l’autre est une adolescente d’une obésité hors norme : elle pèse plus de dix kilos à sa naissance et déchire sa mère dans tous les sens du terme. Cette dernière fuira très vite, ainsi que toutes les nourrices qui se succéderont pour nourrir ce bébé à l’appétit insatiable. Bien sûr on ne peut que penser à Gargantua, le monstrueux bébé de Rabelais. Les illustrations de Gustave Doré ont peut-être inspiré l’auteur, qui sait ? Le livre est tellement visuel ! Cet aspect rabelaisien, ce côté « hénaurme » est essentiel ; la lecture du roman serait insoutenable sans la truculence et l’excès de nourriture, les descriptions gourmandes des repas concoctés par le père aimant, à la fois remèdes et poisons. J’ai été confrontée à l’essai autobiographique d’une personne proche, à celle d’un vieil homme qui était passé par un biographe professionnel et à celui d’une jeune femme qui désirait réorienter sa carrière professionnelle et à qui on avait demandé d’écrire son autobiographie. Elle avait été surprise de la demande, mais elle s’était vite prise de passion pour l’exercice. Je me souviens également d’avoir pratiqué l’exercice avec un adolescent particulièrement violent et perturbé qui avait éructé sur la page un cri de colère et donné un éclairage cru sur la maltraitance paternelle dont il avait été victime. Cela l’avait beaucoup aidé à se calmer. La jeune femme a pu réorienter non seulement sa carrière professionnelle, mais sa vie privée ; son autobiographie était surtout une auto-analyse. Le biographe professionnel avait réussi à rendre plate une vie pleine de péripéties mêlées à l’Histoire, la faute peut-être aux délais, je ne sais pas. Quant à la personne proche, elle avait écrit dans l’urgence, son temps était compté. Elle n’a pas pu travailler son texte.
J’ai été confrontée à l’essai autobiographique d’une personne proche, à celle d’un vieil homme qui était passé par un biographe professionnel et à celui d’une jeune femme qui désirait réorienter sa carrière professionnelle et à qui on avait demandé d’écrire son autobiographie. Elle avait été surprise de la demande, mais elle s’était vite prise de passion pour l’exercice. Je me souviens également d’avoir pratiqué l’exercice avec un adolescent particulièrement violent et perturbé qui avait éructé sur la page un cri de colère et donné un éclairage cru sur la maltraitance paternelle dont il avait été victime. Cela l’avait beaucoup aidé à se calmer. La jeune femme a pu réorienter non seulement sa carrière professionnelle, mais sa vie privée ; son autobiographie était surtout une auto-analyse. Le biographe professionnel avait réussi à rendre plate une vie pleine de péripéties mêlées à l’Histoire, la faute peut-être aux délais, je ne sais pas. Quant à la personne proche, elle avait écrit dans l’urgence, son temps était compté. Elle n’a pas pu travailler son texte. 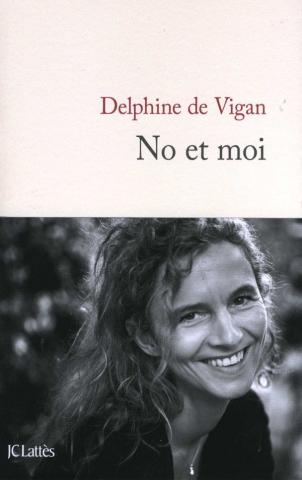 Suite au roman
Suite au roman