Ce texte n’a aucun rapport avec La Servante écarlate et son succès planétaire. Il déroute de premier abord par son aspect, une sorte de collage de différentes nouvelles parues au fil du temps dans des revues diverses. Encore une tentative de régurgitation destinée à masquer le manque d’inspiration ? Pas du tout, ce serait mal connaître Margaret Atwood. Si certaines nouvelles ont déjà été publiées, elles sont intégrées dans un projet d’ensemble qui apparaît dans le titre original, Moral Disorder – Désordre moral.
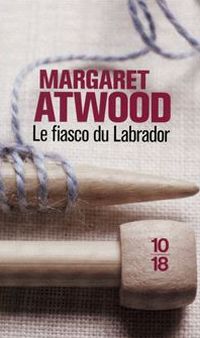 Ce désordre est celui des souvenirs, de la façon chaotique dont ces derniers nous reviennent en mémoire. Le passé surgit au détour d’une phrase anodine, d’un événement minuscule, il ne s’embarrasse pas de logique temporelle. Seuls les écrivains ordonnent les vies ; même lorsqu’ils racontent la leur, ils retravaillent leur matière pour la lisser, il s’agit d’une construction intellectuelle. Margaret Atwood refuse le procédé. Elle choisit bien sûr les éclats de mémoire, les scènes qu’elle va raconter avec beaucoup d’humour ou d’émotion, c’est selon, mais elle respecte ce kaléidoscope, cette concentration de souvenirs désordonnés qui forment une vie, la sienne. Lorsque le texte commence, l’auteure se trouve elle-même au stade de la vieillesse et va nous raconter sa vie de manière à peine déguisée, une vie dans laquelle nous pouvons souvent nous reconnaître. Le hasard de nos choix, les surprises et les accidents qui viennent bouleverser nos projets. Le chaos qui s’ordonne et trouve sens à la fin, parce que nous éprouvons le besoin que tout ce que nous avons vécu ait une signification.
Ce désordre est celui des souvenirs, de la façon chaotique dont ces derniers nous reviennent en mémoire. Le passé surgit au détour d’une phrase anodine, d’un événement minuscule, il ne s’embarrasse pas de logique temporelle. Seuls les écrivains ordonnent les vies ; même lorsqu’ils racontent la leur, ils retravaillent leur matière pour la lisser, il s’agit d’une construction intellectuelle. Margaret Atwood refuse le procédé. Elle choisit bien sûr les éclats de mémoire, les scènes qu’elle va raconter avec beaucoup d’humour ou d’émotion, c’est selon, mais elle respecte ce kaléidoscope, cette concentration de souvenirs désordonnés qui forment une vie, la sienne. Lorsque le texte commence, l’auteure se trouve elle-même au stade de la vieillesse et va nous raconter sa vie de manière à peine déguisée, une vie dans laquelle nous pouvons souvent nous reconnaître. Le hasard de nos choix, les surprises et les accidents qui viennent bouleverser nos projets. Le chaos qui s’ordonne et trouve sens à la fin, parce que nous éprouvons le besoin que tout ce que nous avons vécu ait une signification.
Tout se mélange dans ce texte. Les souvenirs de la petite enfance reviennent au moment où l’auteure et sa jeune sœur doivent rendre visite à leur très vieille mère, se chevauchent avec sa propre vieillesse. Le cours de la vie, la naissance de sa sœur, les amours et leurs complications, le travail, la ferme où elle a vécu avec son compagnon, tout vient de manière chaotique. Il y a beaucoup d’humour dans ces passages, mais celui-ci fait place à une tendresse douloureuse lorsque nous passons au très grand âge des parents. Continuer la lecture


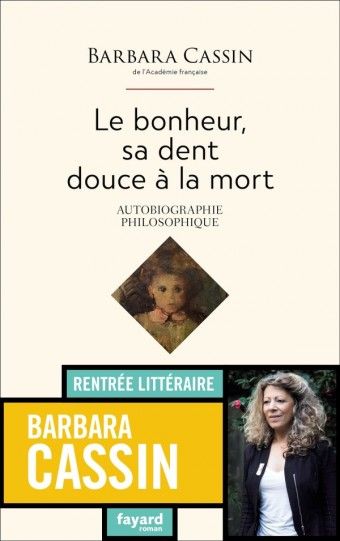
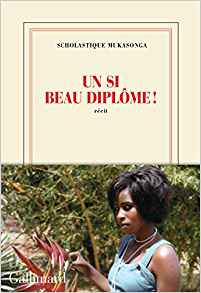 Un si beau diplôme ! raconte l’obstination de l’auteure a obtenir le diplôme d’assistante sociale, c’est le fil conducteur de ce récit autobiographique. Cette quête du diplôme commence dès l’enfance, et ce n’est pas pour rien que l’auteure dédie son livre à son père, Cosmas, « pour qui seule l’école pouvait sauver la mémoire », ce père qui ne voyait de salut pour ses enfants que dans un diplôme. Cosmas savait mieux que personne que les Tutsis étaient en sursis, lui qui avait été forcé d’accepter le regroupement des Hutu et pressentait le pire.
Un si beau diplôme ! raconte l’obstination de l’auteure a obtenir le diplôme d’assistante sociale, c’est le fil conducteur de ce récit autobiographique. Cette quête du diplôme commence dès l’enfance, et ce n’est pas pour rien que l’auteure dédie son livre à son père, Cosmas, « pour qui seule l’école pouvait sauver la mémoire », ce père qui ne voyait de salut pour ses enfants que dans un diplôme. Cosmas savait mieux que personne que les Tutsis étaient en sursis, lui qui avait été forcé d’accepter le regroupement des Hutu et pressentait le pire.  J’ai été confrontée à l’essai autobiographique d’une personne proche, à celle d’un vieil homme qui était passé par un biographe professionnel et à celui d’une jeune femme qui désirait réorienter sa carrière professionnelle et à qui on avait demandé d’écrire son autobiographie. Elle avait été surprise de la demande, mais elle s’était vite prise de passion pour l’exercice. Je me souviens également d’avoir pratiqué l’exercice avec un adolescent particulièrement violent et perturbé qui avait éructé sur la page un cri de colère et donné un éclairage cru sur la maltraitance paternelle dont il avait été victime. Cela l’avait beaucoup aidé à se calmer. La jeune femme a pu réorienter non seulement sa carrière professionnelle, mais sa vie privée ; son autobiographie était surtout une auto-analyse. Le biographe professionnel avait réussi à rendre plate une vie pleine de péripéties mêlées à l’Histoire, la faute peut-être aux délais, je ne sais pas. Quant à la personne proche, elle avait écrit dans l’urgence, son temps était compté. Elle n’a pas pu travailler son texte.
J’ai été confrontée à l’essai autobiographique d’une personne proche, à celle d’un vieil homme qui était passé par un biographe professionnel et à celui d’une jeune femme qui désirait réorienter sa carrière professionnelle et à qui on avait demandé d’écrire son autobiographie. Elle avait été surprise de la demande, mais elle s’était vite prise de passion pour l’exercice. Je me souviens également d’avoir pratiqué l’exercice avec un adolescent particulièrement violent et perturbé qui avait éructé sur la page un cri de colère et donné un éclairage cru sur la maltraitance paternelle dont il avait été victime. Cela l’avait beaucoup aidé à se calmer. La jeune femme a pu réorienter non seulement sa carrière professionnelle, mais sa vie privée ; son autobiographie était surtout une auto-analyse. Le biographe professionnel avait réussi à rendre plate une vie pleine de péripéties mêlées à l’Histoire, la faute peut-être aux délais, je ne sais pas. Quant à la personne proche, elle avait écrit dans l’urgence, son temps était compté. Elle n’a pas pu travailler son texte.