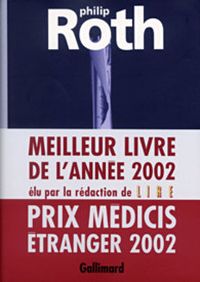 La tache, titre américain The human stain (la tache, la souillure, la honte, la flétrissure humaine), est le troisième roman de la fresque américaine de Philip Roth. Pastorale américaine parlait de la guerre du Viêt Nam, et J’ai épousé un communiste du maccarthysme. En 1998, moment où Philip Roth commence son roman, l’Amérique est en pleine affaire Monika Lewinsky, cette histoire sexuelle qui a pris des proportions délirantes, avec aveux télévisuels du président et le parlement qui doit voter la destitution de Bill Clinton. C’est l’ancrage temporel très précis de ce roman écrit en pleine actualité américaine. Le roman a été publié dans sa version originale en 2000 et sa traduction française en 2002. Il a obtenu le prix Médicis étranger.
La tache, titre américain The human stain (la tache, la souillure, la honte, la flétrissure humaine), est le troisième roman de la fresque américaine de Philip Roth. Pastorale américaine parlait de la guerre du Viêt Nam, et J’ai épousé un communiste du maccarthysme. En 1998, moment où Philip Roth commence son roman, l’Amérique est en pleine affaire Monika Lewinsky, cette histoire sexuelle qui a pris des proportions délirantes, avec aveux télévisuels du président et le parlement qui doit voter la destitution de Bill Clinton. C’est l’ancrage temporel très précis de ce roman écrit en pleine actualité américaine. Le roman a été publié dans sa version originale en 2000 et sa traduction française en 2002. Il a obtenu le prix Médicis étranger.
La tache est l’allusion transparente à ce qui a souillé la robe de la jeune Monika et dont toute l’Amérique, choquée et enchantée, a fait ses choux gras pendant des mois, mais le titre américain est beaucoup plus général que le titre français : la souillure humaine, quasi la honte originelle.
Le livre commence très fort, comme une sorte de transcription de ce qui anime l’Amérique cet été-là :
À l’été 1998, mon voisin Coleman Silk, retraité depuis deux ans, après une carrière à l’université d’Athena où il avait enseigné les lettres classiques pendant une vingtaine d’années puis occupé le poste de doyen les seize années suivantes, m’a confié qu’à l’âge de soixante-et-onze ans il vivait une liaison avec une femme de ménage de l’université qui n’en avait que trente-quatre.
Cet aveu d’une transgression salace n’annonce pas une duplication de l’actualité mais un véritable réquisitoire contre le « politiquement correct », ce conformisme intellectuel qui peut virer à la chasse aux sorcières. Philip Roth nous présente une université gangrenée par la médiocrité et les obsessions du moment, comme le racisme ou le féminisme.
Ancien doyen de la faculté d’Athéna, le très honoré professeur de littérature grecque ancienne Coleman Silk a été accusé deux ans avant le début du roman de racisme par deux élèves qu’il n’avait jamais vus à son cours. Il les avait traités de zombies ; malheureusement le terme a une acception particulière dans le langage populaire, quelque chose comme bamboula. Les deux élèves en question sont noirs, la machine s’emballe. Le professeur démissionne et sa femme Iris meurt peu après. Coleman demande à son voisin et écrivain Nathan Zuckerman d’écrire la façon dont on a assassiné sa femme. Nathan Zuckerman, le double de l’auteur que l’on retrouve dans nombre de ses romans.
L’inculture crasse des étudiants américains devant lesquels s’inclinent leurs professeurs par veulerie et opportunisme est soulignée à plusieurs reprises par Philip Roth ; soit par l’intermédiaire de Delphine Roux, la Française ennemie jurée de Coleman dans le département de littérature ou celui d’Ernestine, la sœur de Coleman :
Du temps de mes parents, et encore du mien et du vôtre, les ratages étaient mis sur le compte de l’individu. Maintenant, on remet la matière en cause. C’est trop difficile d’étudier les auteurs de l’Antiquité, donc c’est la faute de ces auteurs. Aujourd’hui, l’étudiant se prévaut de son incompétence comme d’un privilège. Je n’y arrive pas, c’est donc que la matière pèche, c’est surtout que pèche ce mauvais professeur qui s’obstine à l’enseigner. Il n’y a plus de critères, monsieur Zuckerman, il n’y a plus que des opinions. (p. 406)
La carrière d’un homme qui a rendu à l’université son prestige intellectuel en virant tous les médiocres et les paresseux, celle d’un homme qui a engagé le premier enseignant noir d’Athéna, est ruinée parce qu’il a utilisé un terme dans son acception réelle et non argotique. Coleman Silk ne trouvera aucun soutien parmi les enseignants qu’il a nommés, pas même auprès de ce professeur qui lui doit sa carrière.
Lâcheté et fuite en avant des milieux intellectuels, démission devant la médiocrité.
Le professeur ne sert pas seulement à une brillante démonstration, il est le héros de cette tragédie grecque dont il a enseigné la violence et la cruauté à ses élèves. On n’échappe pas à son destin, nous disent les tragédies antiques, on se rebelle mais on paie le prix fort.
Coleman Silk (la soie en anglais, faut-il le préciser) a transgressé toute sa vie. Il a refusé le destin qui lui était imposé, s’est créé une identité qui lui a imposé la rupture totale avec sa famille d’origine. Cette histoire de sexe de la fin de sa vie avec une femme qui se prétend illettrée est peut-être la dernière transgression dont il s’est rendu coupable. La fin ne peut être que tragique, bien sûr, et les commérages qui suivront sa mort rappelleront l’actualité américaine à l’origine du roman.
La tache est un texte d’une grande puissance, un torrent qui étrille cette Amérique bien-pensante que vomit l’auteur. Il met à nu la façon dont on a traité les anciens combattants du Viêt Nam avec Les Farley, l’ex mari de Faunia la femme de ménage. Il montre l’exploitation des miséreux avec Faunia. Le conformisme et le naufrage de l’éducation à travers l’université d’Athéna et la façon dont elle a traité un homme respecté.
Nous sommes loin d’un roman à thèses, plutôt dans une immersion au bord de l’asphyxie dans la vie des personnages. L’extraordinaire travail sur les personnages secondaires comme Delphine Roux, l’ennemie intime de Coleman dans le département me sidère. Ce roman contient plusieurs romans qui pourraient se suffire à eux-mêmes. Bien sûr, Nathan Zuckerman est présent, le plus discret des personnages comme il se doit pour un prédateur qui doit engloutir la vie des autres pour mieux la restituer. Coleman est conscient de ce qu’il offre au romancier :
Que je sombre dans les confidences. Que j’égrène le passé en sa compagnie. Que je le fasse m’écouter. Que je lui aiguise son sens de la réalité, à ce romancier. Que je nourrisse la conscience d’un romancier, avec ses mandibules toujours prêtes. Chaque catastrophe qui s’abat lui est matière première. La catastrophe, c’est sa chair à canon. Mais moi, en quoi la transformer ? elle me colle à la peau. Je n’ai pas le langage, moi, la forme, la structure, la signification ; je me passe de la règle des trois unités, de la catharsis, de tout. (p. 215)
Mais le romancier ne vit pas sans danger :
Voilà ce qui arrive quand on écrit des livres. Ce n’est pas seulement qu’une force vous pousse à partir à la découverte des choses ; une force les met sur votre route. Tout à coup, tous les chemins de traverse se mettent à converger sur votre obsession. (p. 422-423)
Un romancier se prend pour Dieu, et lui aussi doit payer le prix de sa transgression.
J’aimerais faire mention de la superbe traduction de Josée Kamoun en donnant pour exemple la description de Coleman par le narrateur-écrivain :
Vu de près, ce visage était talé et abîmé comme un fruit tombé de son étal et dans lequel les chalands successifs ont donné des coups de pieds au passage. (p. 24) […]
Coleman avait cette joliesse incongrue, ce visage de marionnette presque, que l’on voit aux acteurs vieillissants jadis célèbres à l’écran dans des rôles d’enfants espiègles, et sur qui l’étoile juvénile s’est imprimée, indélébile. (p. 27)
Si La tache vous a échappé lors de sa parution, réparez votre erreur : les tares de l’Amérique ne sont pas guéries…
La tachePhilip Roth
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun
Gallimard, août 2002, 448 p., 25 €
ISBN : 9782070759071
Devenir femme, c’est affronter le couteau. C’est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. Et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d’avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière tous les samedis. Ou bien on se perd, ou bien on se trouve.

 Le
Le  Voilà ce qu’il écrit au début de
Voilà ce qu’il écrit au début de 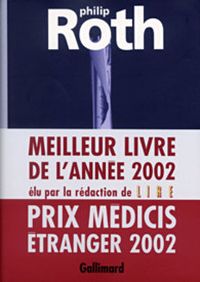 La tache, titre américain The human stain (la tache, la souillure, la honte, la flétrissure humaine), est le troisième roman de la fresque américaine de Philip Roth. Pastorale américaine parlait de la guerre du Viêt Nam, et J’ai épousé un communiste du maccarthysme. En 1998, moment où Philip Roth commence son roman, l’Amérique est en pleine affaire Monika Lewinsky, cette histoire sexuelle qui a pris des proportions délirantes, avec aveux télévisuels du président et le parlement qui doit voter la destitution de Bill Clinton. C’est l’ancrage temporel très précis de ce roman écrit en pleine actualité américaine. Le roman a été publié dans sa version originale en 2000 et sa traduction française en 2002. Il a obtenu le prix Médicis étranger.
La tache, titre américain The human stain (la tache, la souillure, la honte, la flétrissure humaine), est le troisième roman de la fresque américaine de Philip Roth. Pastorale américaine parlait de la guerre du Viêt Nam, et J’ai épousé un communiste du maccarthysme. En 1998, moment où Philip Roth commence son roman, l’Amérique est en pleine affaire Monika Lewinsky, cette histoire sexuelle qui a pris des proportions délirantes, avec aveux télévisuels du président et le parlement qui doit voter la destitution de Bill Clinton. C’est l’ancrage temporel très précis de ce roman écrit en pleine actualité américaine. Le roman a été publié dans sa version originale en 2000 et sa traduction française en 2002. Il a obtenu le prix Médicis étranger.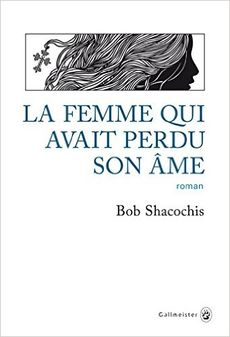 Il a fallu presque huit cents pages et dix ans de sa vie à Bob Shacochis, journaliste et ancien correspondant de guerre, pour dresser dans le désordre une fresque de notre monde issu de la seconde guerre mondiale. Œuvre ambitieuse et plutôt réussie, à quelques réserves près.
Il a fallu presque huit cents pages et dix ans de sa vie à Bob Shacochis, journaliste et ancien correspondant de guerre, pour dresser dans le désordre une fresque de notre monde issu de la seconde guerre mondiale. Œuvre ambitieuse et plutôt réussie, à quelques réserves près.